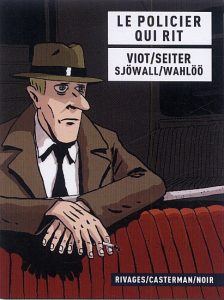 Si vous avez raté le début : La police suédoise découvre un bus dont les passagers sont criblés de balles. Le commissaire Martin Beck, chargé de l’enquête découvre avec stupeur que l’une des victimes n’est autre que l’un de ses enquêteurs.
Si vous avez raté le début : La police suédoise découvre un bus dont les passagers sont criblés de balles. Le commissaire Martin Beck, chargé de l’enquête découvre avec stupeur que l’une des victimes n’est autre que l’un de ses enquêteurs.
Depuis les invasion normandes, on avait appris à s’inquiéter à la vue de drakkars vikings sur les côtes. Après la sortie du film Festen, on s’était dit que les danois avaient un curieux sens de la famille. La trilogie Millenium de Stieg Larson pouvait amener à s’interroger sur les règles du tutorat en Suède. Cette adaptation d’un polar écrit par Maj Sjöwall et Per Wahlöö se devait donc, en principe, de faire honneur à la réputation de glauque, d’horreur et de tripaille dont semblent être friands les auteurs de fictions scandinaves.
Cela commence plutôt bien. En effet le départ de ce roman se situe sur la scène de crime : la cabine d’un bus dont les passagers baignent dans le sang après avoir été mitraillés. On pense dès lors, avec nos habitudes de lecteur d’aujourd’hui, à un crime aveugle commis par on ne sait quel fou psychotique. Seulement le roman qui a servi à cette adaptation a été écrit il y a quarante ans, à une époque où les serials killers n’avaient pas complètement envahi livres et séries policières. Il va donc falloir aux enquêteurs se creuser un peu plus les méninges et mettre un peu de cohérence au milieu de ce carnage. C’est l’occasion pour les auteurs de détailler le travail de fourmi, lent, bien souvent ingrat que les policiers de la ville de Stockholm doivent fournir pour espérer aboutir : enquêtes de voisinage, expertises scientifiques, filatures, consultations d’archives. On quitte le domaine de l’hémoglobine pour entrer dans le détail de l’enquête proprement dite.
De plus avec un pareil titre, le lecteur s’attend par antithèse à un héros sinistre. Mais heureuse surprise, il ne l’est pas tant que ça et il faut reconnaitre que le commissaire est parfois à deux doigts d’être guilleret, ce qui vient relever l’ambiance grise et hivernale que restitue bien Martin Viot par son dessin.
Reconnaissons qu’on est un peu dérouté et qu’on en viendrait presque à regretter une petite scène de torture ou de découpage de corps ligoté déci delà.
Lafigue.
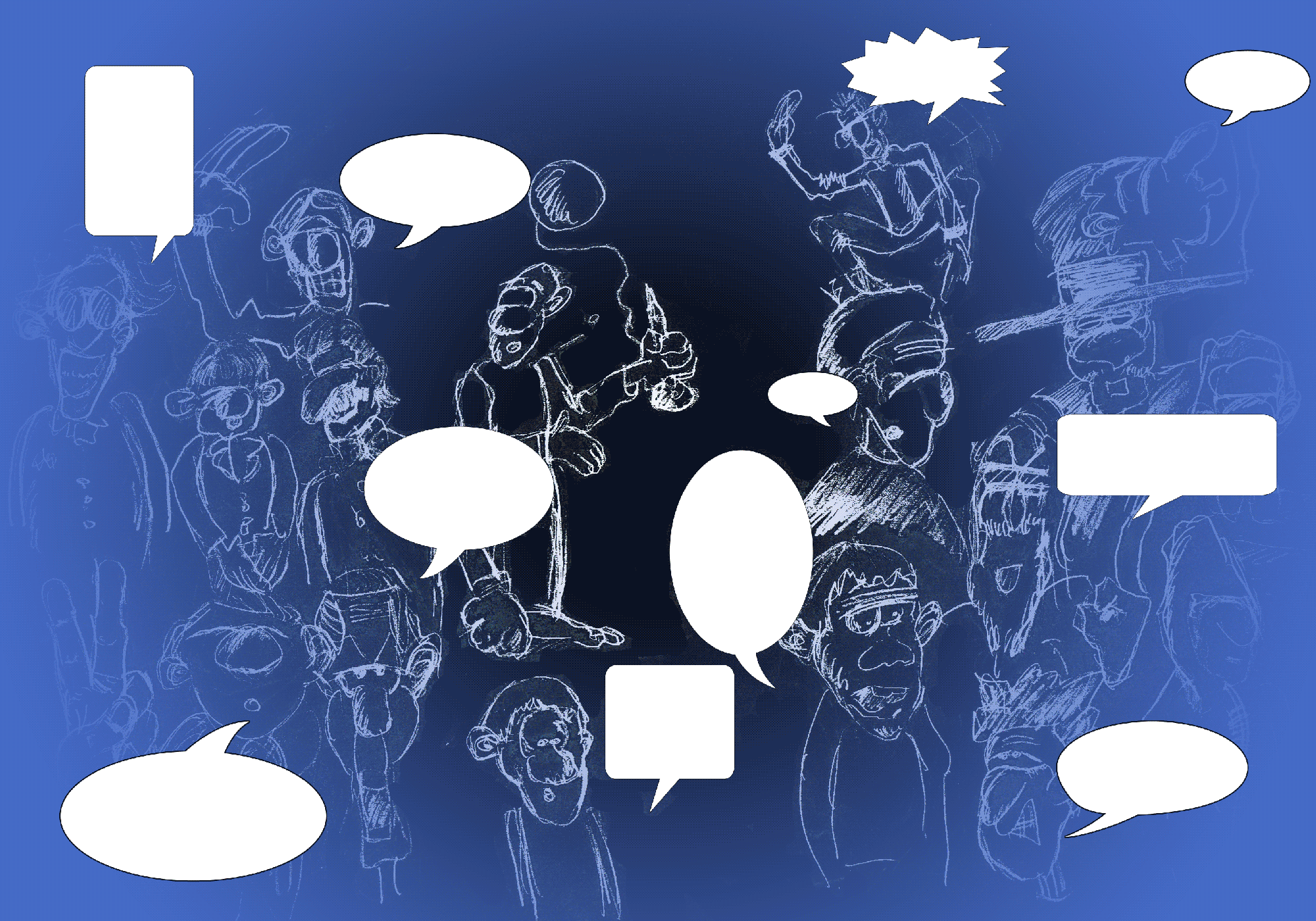
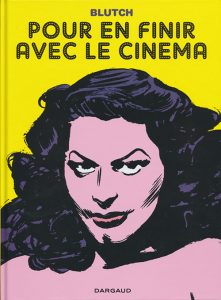 De quoi s’agit t’il : Blutch explore le cinéma et tente, à travers quelques gueules et scènes d’anthologies diverses, de comprendre ce qui irrépressiblement l’obsède dans le 7eme art.
De quoi s’agit t’il : Blutch explore le cinéma et tente, à travers quelques gueules et scènes d’anthologies diverses, de comprendre ce qui irrépressiblement l’obsède dans le 7eme art.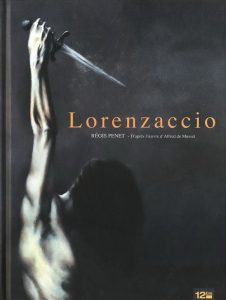 On imagine souvent le mouvement romantique comme le paroxysme de la sensiblerie autour duquel pullule une armada de chochottes fondant en larmes à la moindre vue d’une aile de papillon. En dehors de toute considération de style où je ne m’aventurerai pas, c’est peut être la violence extrême des sentiments qui caractérise le mieux ce courant littéraire.
On imagine souvent le mouvement romantique comme le paroxysme de la sensiblerie autour duquel pullule une armada de chochottes fondant en larmes à la moindre vue d’une aile de papillon. En dehors de toute considération de style où je ne m’aventurerai pas, c’est peut être la violence extrême des sentiments qui caractérise le mieux ce courant littéraire. De quoi s’agit t-il : trois secondes, il n’en faut pas plus à la lumière pour ricocher dans tous les coins de la ville et permettre au lecteur de suivre le fil d’une intrigue policière à travers de multiples reflets
De quoi s’agit t-il : trois secondes, il n’en faut pas plus à la lumière pour ricocher dans tous les coins de la ville et permettre au lecteur de suivre le fil d’une intrigue policière à travers de multiples reflets